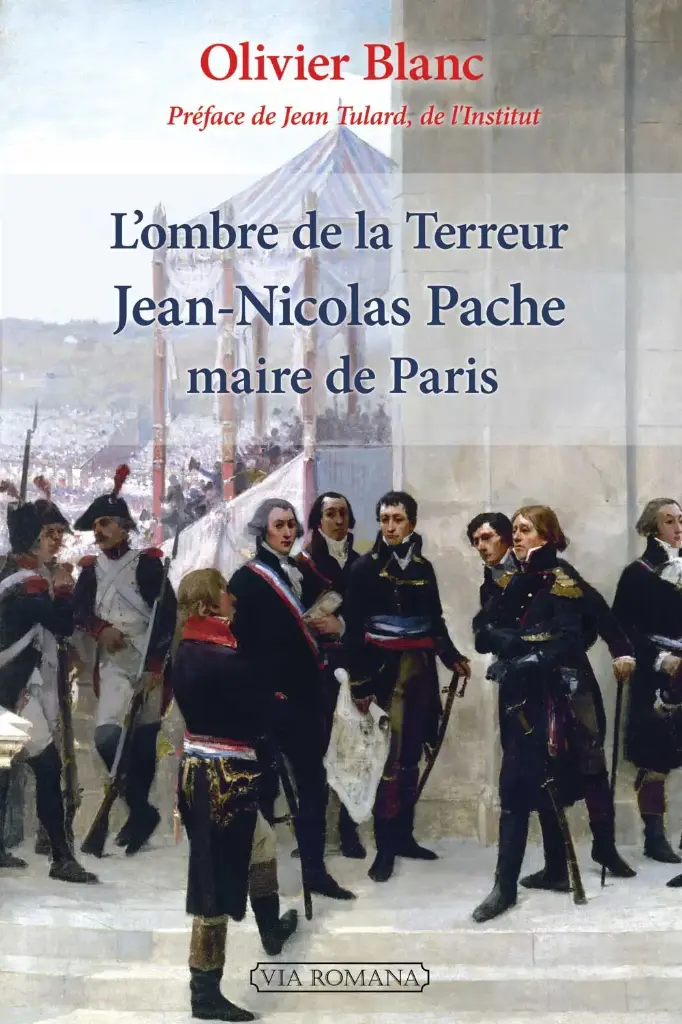L’historiographie retenait de Pache qu’il avait partie liée avec les « Enragés » et les partisans d’une guerre civile paroxystique au sein de la Révolution : un monstre donc pour ses ennemis, depuis les contre-révolutionnaires et les « modérés », jusqu’aux Girondins et à ceux des Jacobins qui s’opposent aux Cordeliers, les dantonistes et même Saint-Just…
Un monstre peut-être, mais un monstre de duplicité, selon les découvertes documentaires d’Olivier Blanc : c’est là tout l’intérêt de la biographie d’un personnage représentatif des contradictions, des hypocrisies et des non-dits d’une période charnière.
D’origine suisse, Pache est (et reste) familier de la maison du maréchal de Castries, ministre de la Marine de Louis XVI. Passé par l’École royale du Génie de Mézières, il y forme de solides amitiés – qui restent de sa complicité tout au long de sa carrière ; ainsi du mathématicien Monge qu’il pousse sous la Révolution au ministère de la Marine (au détriment de celle-ci…).
Ayant acquis de solides compétences dans l’administration royale, il est promu au vu de son expérience professionnelle jusqu’au poste de ministre de la Guerre en 1792. Rien d’exceptionnel jusque là, pour un acquéreur (comme tant d’autres) d’importants biens nationaux et pour un homme de réseaux, où il tisse de solides appuis, comme Barère de Vieuzac, l’indéfectible rapporteur du Comité de Salut Public, dont la trajectoire est comparable à la sienne jusque sous la Restauration.
Mais là où les apparences deviennent trompeuses, c’est que ces réseaux se croisent, étroitement parfois, avec ceux de la contre-révolution : réseaux multiples, ceux des émigrés en Angleterre avec Calonne, ceux de son ancien protecteur Castries, ceux, à Paris, de l’Espagne opposée aux Anglais sur la paix à faire avec la France, ceux du baron de Batz et, pourquoi pas, ceux des chouans.
Tacite complice (voire instigateur) des Septembriseurs, Pache fait tout, comme ministre de la Guerre, pour contrarier Dumouriez, détournant les fournitures aux armées, comme plus tard, maire de Paris, il empêche en sous-main les approvisionnements de la capitale : comme s’il s’agissait, dès 1792, de favoriser la coalition et plus tard l’émeute parisienne contre la Convention, sous la Terreur.
Bourreau des Girondins – après avoir trahi la confiance de Roland –, protecteur occulte des affairistes comme le brasseur Santerre, des concussionnaires, des généraux ravageurs de la Vendée, Pache a poussé à sa succession au département de la Guerre l’incapable Bouchotte (le von Buchholz des princes allemands…). Par ses détournements, Pache peut stipendier grassement des journaux comme celui d’Hébert (« L’ami du peuple » de Marat recevait déjà de l’argent de la contre-révolution). Maire, il peut acheter la fidélité des sectionnaires parisiens au prix de deux francs par jour et par tête ; le tout en éliminant les témoins et se gardant d’y paraître quitte à laisser tomber ses complices, Hébert, Chaumette, quand le vent aura tourné.
Et tout cela pour quoi ? Pour assurer si faire se peut la domination de la Commune de Paris sur les départements et sur la Convention, pour exaspérer la Révolution dans une guerre civile où elle devrait se perdre : c’est l’espoir des officines contre-révolutionnaire, c’est l’attente du ministre anglais Pitt qui escomptait, lui, le démembrement de la France, plus qu’une Restauration.
Les documents et références d’archives mis au jour par O. Blanc éclairent cette duplicité d’un Pache, ultra (révolutionnaire, ou contre-révolutionnaire ?) de l’ombre : il aura contribué à faire couler des bains de sang mais reste assez adroit, comme Barère, pour temporiser, surnager en prison après Thermidor, être amnistié finalement et se faire oublier…
Jusqu’à la Restauration où, notable et académicien, retiré sur ses terres, celles d’une ancienne abbaye, il meurt paisiblement en 1818, muni à sa demande des sacrements de l’Église par un ancien prêtre réfractaire. Son fils, officier de l’armée impériale puis de Louis XVIII, sera anobli ; son gendre et ancien complice créé baron par Charles X.
Je me demandais, a priori, pourquoi Via Romana éditait la biographie d’un terroriste « enragé », pourquoi Jean Tulard la préfaçait. Le texte d’O. Blanc éclaire opportunément les dessous de ces temps et de ces engagements de girouettes ( ?), à moins qu’il ne s’agisse de convictions ( permanentes ou successives ?) ou encore de parfait cynisme. L’auteur a en tout cas le grand mérite de mettre à mal les simplifications marxisantes d’une historiographie de la Révolution et de la Terreur trop officiellement dominée depuis Aulard par Mathiez et ses successeurs.
Philippe BONNICHON
Ancien élève de l’École Normale supérieure de la rue d’Ulm,
agrégé et docteur en Histoire, Maître de conférences (h.)
de l’Université de Paris IV Sorbonne