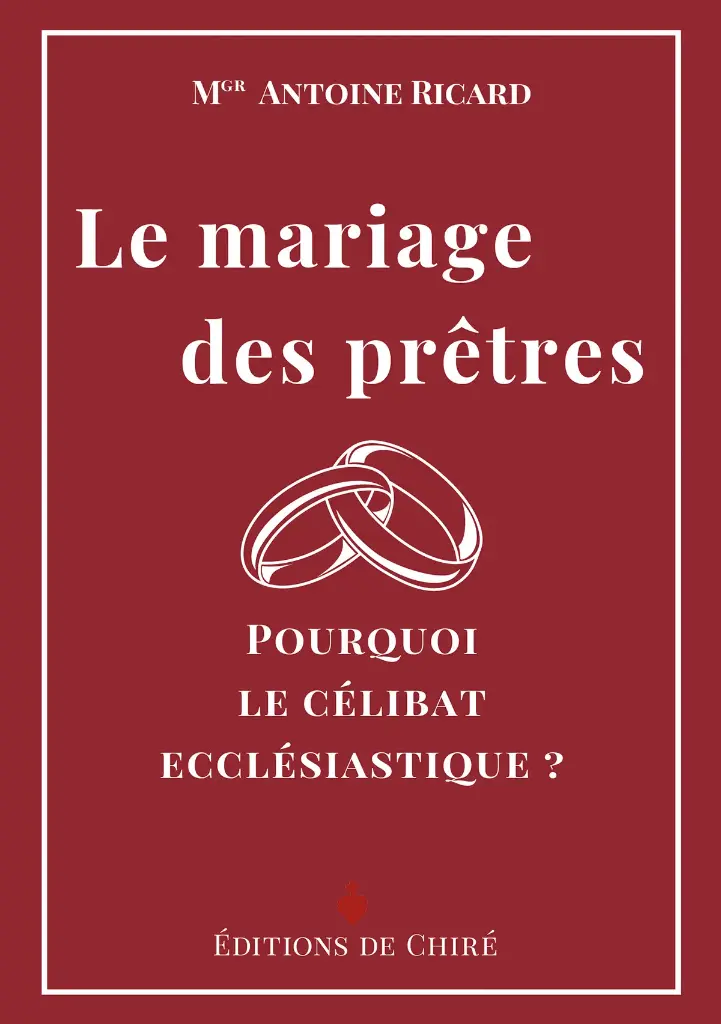Le mariage des prêtres - Pourquoi le célibat ecclésiastique ?
Date de parution :
07 avr. 2025
Auteur :
RICARD (Mgr Antoine)
Éditeur :
CHIRE (EDITIONS DE)
EAN 13 :
9782851903570
Nb de pages :
44
Référence interne:
132228
Description
Régulièrement, tel un serpent de mer, la question du mariage des prêtres revient sur le devant de la scène. Depuis la « révolution copernicienne » de Vatican II, qui a ébranlé bien des certitudes, les théologiens d’avant-garde et leurs relais médiatiques en ont fait la panacée qui est censée devoir remédier à la crise des vocations et à tous les maux afférents.
Est-il cependant si opportun, est-il même possible au regard de la Tradition de passer par pertes et profits le célibat des clercs et les principes ascétiques éprouvés par les siècles ?
C’est à un grand public, y compris catholique, déjà ignorant des motivations et de l’histoire du célibat ecclésiastique, et déjà travaillé par la propagande ennemie qui, de tout temps, et notamment depuis le XIXe siècle, en a fait une arme de guerre, que Mgr Antoine Ricard (1834-1895) avait destiné cette étude, publiée en 1887 : elle permettra encore aujourd’hui à tous de comprendre les vrais enjeux de cette question, et aux catholiques de rendre raison face au monde de l’antique discipline de leur mère l’Église.
| Titre | Le mariage des prêtres - Pourquoi le célibat ecclésiastique ? |
| Auteur | RICARD (Mgr Antoine) |
| Éditeur | CHIRE (EDITIONS DE) |
| Date de parution | 07 avr. 2025 |
| Nb de pages | 44 |
| EAN 13 | 9782851903570 |
| Présentation | Brochure |
| Épaisseur (en mm) | 3 |
| Largeur (en mm) | 148 |
| Hauteur (en mm) | 210 |
| Poids (en Kg) | 0,250 |
Lu dans Lectures Françaises
Les éditions de Chiré ont pris l’heureuse initiative de tirer de l’oubli cette étude destinée au grand public et consacrée au célibat ecclésiastique .
Mgr Antoine Ricard (1834-1895), ordonné prêtre pour le diocèse de Marseille en 1857, aumônier et professeur dans l’enseignement secondaire, compléta ses études et décrocha le doctorat en théologie en 1865. Il fut titulaire d’une chaire à la faculté de théologie de l’université d’Aix-en-Provence, de 1878 à 1885, date à laquelle cette même faculté fut supprimée d’un trait de plume par le gouvernement de la République.
Mgr Ricard est connu pour ses travaux de traduction, pour plusieurs biographies, pour de très nombreux articles et brochures, mais aussi pour un livre-testament aujourd’hui disponible aux éditions Saint-Rémi : La Mission de la France. Il était membre de l’Académie des sciences, lettres et arts de Marseille, et le pape Léon XIII l’avait élevé à la dignité de prélat de la Maison de Sa Sainteté.
Pourquoi avoir réédité cette étude – « Le mariage des prêtres » – publiée originellement en avril 1887 dans la Revue du monde catholique ?
Il existe aujourd’hui quelques études savantes sur la question, mais peu de publications destinées au grand public. Car c’est bien au grand public que s’adressait Mgr Ricard. Or c’est au grand public que s’adresse depuis des décennies, sinon des siècles, la propagande éhontée des ennemis déclarés ou insidieux de l’Église en faveur du mariage des prêtres.
Cette propagande est aujourd’hui alimentée par les scandales qui défraient la chronique. Face à la crise des vocations, face aux défections et face aux « abus cléricaux » qui crient vengeance, le mariage des prêtres serait la panacée. Comme si, dans notre monde apostat, l’infidélité, le divorce, les abus en tous genres et même la peur et la fuite des engagements n’étaient pas endémiques et n’affectaient pas profondément le cadre familial et l’institution matrimoniale. Les sociétés occidentales sont profondément malades. La crise des vocations et celle du mariage s’expliquent par la raréfaction des familles catholiques, elle-même provoquée par l’apostasie quasi générale et par l’effondrement des mœurs qui l’accompagne. Ce n’est pas en passant par pertes et profits les préceptes de la foi et les principes ascétiques éprouvés par les siècles que les fidèles et les ministres du culte seront capables de se comporter encore en chrétiens dans un monde qui ne l’est plus.
On nous présente le célibat ecclésiastique comme une pure question disciplinaire qui pourrait souffrir d’être réformée. On prend prétexte de la lutte engagée au xie siècle par les papes de la réforme grégorienne, pour la liberté de l’Église et pour le célibat des clercs, pour donner accroire que cette discipline a alors vu le jour en tout et pour tout, comme s’il s’était alors agi d’une nouveauté proprement mirobolante. On s’appuie sur les pratiques en vigueur dans l’Orient chrétien, sans en donner le détail ni l’histoire.
Le père jésuite Christian Cochini (1929-2017), qui consacra sa thèse de doctorat aux origines apostoliques du célibat sacerdotal – thèse dont est tiré l’ouvrage du même nom (éd. Ad Solem, 2006), a réussi à établir que la continence des clercs remonte aux apôtres et en expose les raisons, s’appuyant notamment sur la parole de l’évêque Geneclius, adoptée par le concile de Carthage, en l’an 390 : « Il convient que les saints évêques et les prêtres de Dieu, ainsi que les lévites, c’est-à-dire ceux qui sont au service des sacrements divins, observent une continence parfaite, afin de pouvoir obtenir en toute simplicité ce qu’ils demandent à Dieu ; ce qu’enseignèrent les apôtres, et ce que l’antiquité elle-même a observé, faisons en sorte, nous aussi, de le garder. » « Par cette affirmation », expliquait le père Cochini, « la discipline ecclésiastique des premiers siècles cherchait à s’inscrire dans la ligne des principes posés par le Nouveau Testament, et, au-delà de l’Évangile, à rattacher le sacerdoce chrétien à l’institution lévitique ».
Certes, en 692, le concile in Trullo réuni en Orient par l’empereur Justinien II, prétendit faire de l’usage du mariage un droit pour les hommes élevés au sacerdoce après leur mariage. Il est à noter que cette disposition ne fut pas ratifiée par les légats du Pape, et que la discipline orientale, qui impliquait néanmoins la continence périodique en vue de l’exercice du ministère, fut tolérée par l’Église romaine qui, de son côté, en Occident, imposa en définitive la continence perpétuelle des clercs. Mgr Ricard, dans son étude, donne à voir les difficultés bien réelles de la discipline orientale.
À aucun moment cependant, sinon du côté de Luther, de ses émules et de ses précurseurs, il ne fut envisagé d’accorder aux prêtres le droit de se marier et de reconnaître pareilles unions comme valides. C’est ce qui ressort très clairement du décret sur le mariage du concile de Trente et plus précisément de son canon 9 : « Si quelqu’un dit que les clercs engagés dans les ordres sacrés […] peuvent contracter mariage, et que ce mariage est valide, nonobstant la loi ecclésiastique […] qu’il soit anathème. »
Le grand public n’a pas le temps de se plonger dans la thèse du père Cochini. Il trouvera sous la plume de Mgr Ricard l’expression de la tradition de l’Église. Le lecteur pourra alors rendre raison de ses convictions et opposer les vérités attestées par l’histoire à la propagande du mensonge.
Vincent CHABROL
Vous aimerez aussi
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.